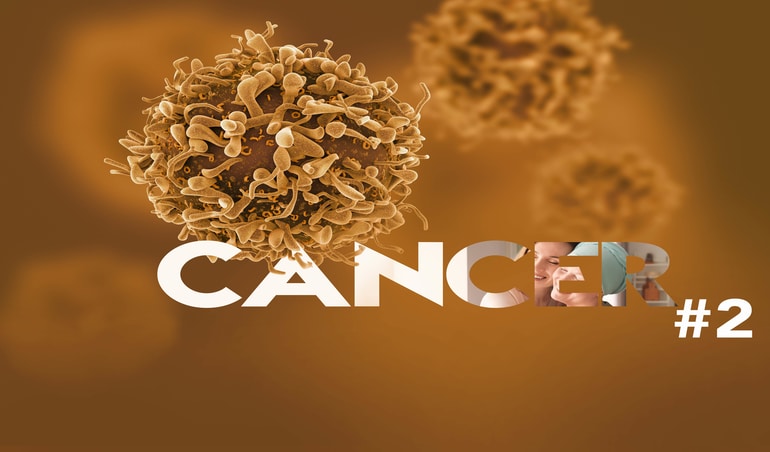
Avancées et impasses sur le cancer / #2 Va-t-on trop loin dans le dépistage ?
Les experts du dépistage du cancer règlent souvent leurs comptes en public. Cela laisse le non-spécialiste dans une certaine perplexité sur la démarche à adopter. Le spécialiste aussi.
Par Maël Lemoine, philosophe des sciences médicales.

Découvrir l'article précédent → Avancées et impasses sur le cancer #1 / Panorama
Plus tôt un cancer est traité, plus grandes sont les chances de survie. Mais plus tôt un « cancer » est diagnostiqué, plus incertain est l’intérêt, ou la nocivité, du traitement. Si le cancer se définit comme une lésion invasive, il n’y a pas de cancer avant l’invasion. Mais l’invasion elle-même est déjà un stade tardif de traitement. Que se passe-t-il avant l’invasion ? Il existe des lésions précancéreuses et des lésions procancéreuses, et des lésions cancéreuses « indolentes » qui n’évolueront pas, comme les microcarcinomes papillaires de la thyroïde.
Face à cette situation difficile, la tendance est de pencher vers l’un ou l’autre de deux types de simplification opposés. Le premier raisonnement simplificateur peut se résumer sous la formule : « on ne sait jamais ». Il consiste à se dire que quand l’enjeu est la mort, toute alternative est préférable. Ce raisonnement donne donc systématiquement dans le dépistage et dans le traitement précoce, quel qu’en soit le coût.
Le second raisonnement simplificateur peut être résumé par la formule : « ils nous mentent ». Il consiste en un scepticisme généralisé sur la précision du dépistage, l’efficacité du traitement, le pronostic du cancer. C’est le nihilisme médical d’un Ivan Ilitch, dont il faut rappeler qu’il décida sciemment de ne pas être traité pour une tumeur avec laquelle il vécut les 20 dernières années de sa vie.
Si quelqu’un décidait de ne se ranger systématiquement ni à l’un, ni à l’autre de ces raisonnements simplificateurs dans toutes les situations, comment déciderait-il ? Le choix le plus évident est de décider par pathologie : on décide ainsi, par exemple, de faire confiance au dépistage généralisé du cancer de la peau par examen clinique, mais de ne plus faire confiance aux PSA dans le cancer de la prostate. C’est ainsi que la plupart des décisions sont prises : des recommandations générales plus ou moins spécifiques, prenant en compte certaines caractéristiques comme l’âge et l’hérédité. Cette approche clarifie indubitablement la situation et permet de limiter l’impact des décisions à l’emporte-pièce. Reste que dans le cas particulier de chaque type de cancer, la question se pose à nouveau dans les mêmes termes, même si les données ne sont pas les mêmes.

Sensibilité et spécificité
Rappelons qu’il n’existe pas de test diagnostique parfait. Chaque test se caractérise par une sensibilité, c’est-à-dire, sa capacité à détecter une plus ou moins grande partie des cas de maladie. Si l’on admet que 4 patients atteints de cancer de la prostate sur 5 ont un taux de PSA élevé, c’est un test assez sensible.
Un test se caractérise aussi par sa spécificité, qui est sa capacité à éliminer une plus ou moins grande partie des cas de non-maladie. Un test diagnostique parfait serait donc parfaitement sensible et détecterait tous les cas de maladie. En admettant qu’un patient a effectivement un cancer de la prostate, pour deux autres dont le taux est élevé sans cancer de la prostate, la spécificité du test est de 33%, ce qui est faible. Le test des PSA est effectivement assez sensible, mais peu spécifique. L’adopter, c’est prioriser la sensibilité sur la spécificité.
L’exemple du test des PSA
On privilégie la sensibilité quand on a peur de ne pas traiter des patients atteints. On privilégie la spécificité quand on a peur de traiter des patients non-atteints. Il est raisonnable de privilégier la sensibilité quand les effets secondaires d’un traitement sont négligeables ou ses inconvénients inexistants. Il est raisonnable de privilégier la spécificité quand une maladie est rare et quand les effets secondaires et les inconvénients du traitement sont importants.
La préconisation du test des PSA dans le cancer de la prostate est un bon exemple. Quand il n’existait pas d’autre test que la palpation, ce test sanguin a été salué comme une avancée majeure à cause de sa sensibilité et de son acceptabilité. Il est aujourd’hui remis en cause. Certains préconisent par exemple de le combiner avec la palpation, les ultrasons, ou la biopsie pour déterminer l’agressivité du cancer (son « grade »). Mais il existe plusieurs manières de le faire, et ces examens eux-mêmes ne sont pas sans conséquences sur l’ensemble de la population, même si le médecin peut les juger mineures pour le patient particulier qu’il a en face de lui. Apprendre qu’on est « surveillé » pour sa prostate n’est pas anodin. Apprendre qu’on a un cancer de bas grade conduit assez naturellement à vouloir s’en débarrasser plutôt que d’attendre.
L’intérêt du dépistage dans une population
Les experts soulignent que pour évaluer le gain absolu d’une technique de dépistage, il faut comparer à la situation antérieure où aucun dépistage n’existait. Mais l’acceptabilité sociale d’une situation sans dépistage est faible, pour les médecins comme pour leurs patients. On peut donc comparer les gains éventuels d’une nouvelle technique de dépistage aux techniques standard. Mais en l’absence de « gold standard » parfaitement fiable, c’est-à-dire de critère de référence incontestable de la présence d’un cancer, la mesure ne vaut au mieux que ce que vaut le critère de référence adopté.
On peut choisir de diagnostiquer un cancer rétrospectivement pour se donner, par exemple, une estimation de la fréquence des tumeurs qui n’évoluent pas. Des prélèvements post-mortem permettent ainsi d’estimer l’extrême prévalence des cancers « indolents » : prostate ou sein notamment. On peut aussi assurer un suivi prospectif serré et de long terme pour des patients dont le cancer est diagnostiqué, le choix étant fait d’une intervention rapide en cas d’évolution inquiétante. C’est ce qui a été fait, notamment, pour les microcarcinomes papillaires de la thyroïde, avec des résultats troublants : menée sur soixante ans, une étude japonaise a ainsi mis en évidence la très faible fréquence d’évolutions péjoratives.
Des prélèvements post-mortem permettent [...] d’estimer l’extrême prévalence des cancers « indolents » :
prostate ou sein notamment.
Quoique informatives, ces mesures demeurent cependant imparfaites. D’abord, elles sont difficilement généralisables – l’échographie de la thyroïde peut être pratiquée sans trop de contraintes beaucoup plus souvent que la radiographie mammaire, par exemple. Ensuite, elles restent difficilement acceptables à cause de l’anxiété qu’elles génèrent – tôt ou tard, il existe la tentation de « se débarrasser une fois pour toutes du problème ». Le dépistage engendre, qu’on le veuille ou non, une population de « rescapés artificiels », beaucoup plus importante que la population de patients sauvés par le dépistage. Bien malin est celui qui peut dire si c’est une situation satisfaisante.
Un gonflement artificiel des bons chiffres
Un problème plus pervers est régulièrement pointé par les spécialistes. On accepte généralement l’idée que le taux de survie est fortement corrélé à la précocité de l’intervention. Mais plus l’intervention est précoce, plus nombreux sont ces « rescapés artificiels ». Quand il s’agit donc d’évaluer rétrospectivement l’intérêt du dépistage précoce, il est rare qu’on n’observe pas une amélioration du taux de survie. Cependant, celui-ci est calculé à partir de la survie de la population traitée, puisqu’il est impossible de faire abstraction des patients dépistés qui n’étaient pas vraiment malades – on ne sait pas combien ils sont. Ce serait un comble que ceux qui n’avaient pas vraiment de cancer fassent grimper la courbe de mortalité par cancer. Au contraire, ils la font descendre artificiellement. La surdétection conduit de manière perverse à une surévaluation des taux de survie qui renforce à son tour l’idée qu’il faut détecter tôt.
Si l’on ôtait la prostate de tous les hommes à l’âge de 18 ans, le taux de survie serait de 100%. S’il est passé aux Etats-Unis de 83% à 99%, c’est dans une certaine mesure par dilution du nombre des morts dans une population non concernée. Dans l’absolu, c’est aussi absurde que si l’on comptait les femmes dans la sensibilité et la spécificité du taux de PSA. Bien sûr, la différence est qu’on ne sait justement pas quels hommes ont vraiment un cancer. Cela n’évacue pas le problème pour autant.
Les déterminants scientifiques de la décision
Il existe deux déterminants importants dans l’amélioration des décisions en matière de dépistage : des éléments factuels et des éléments décisionnels à proprement parler.
En termes philosophiques, le dépistage du cancer souffre d’abord, selon la philosophe Anya Plutynski, de « sous-détermination empirique ». Cela signifie que les décisions ne sont pas parfaitement étayées par des faits dans l’état actuel des connaissances. On décide de dépister avec des tests imparfaits, certes, mais on ne sait pas exactement quels sont les effets de ces décisions en termes de faux positifs et de faux négatifs.
C’est un problème largement scientifique. Un problème biologique d’abord : on ne peut découvrir de nouveaux tests sans entrer dans la biologie du cancer. C’est aussi un problème épidémiologique : sur quelles populations et comment mener les mesures pour obtenir des estimations fiables de la pertinence des traitements et de l’efficience d’une pratique de dépistage ?
Le patient fait ses choix en matière de santé en fonction de ce qu’il valorise dans la vie. C’est aller bien vite en besogne que d’affirmer, comme on l’entend dire souvent aux professionnels de santé, que la santé est la valeur suprême.
C’est un problème conceptuel, voire philosophique enfin : que décide-t-on en effet vraiment d’appeler « cancer » ? Récemment, un groupe de chercheurs influents a proposé de cesser d’utiliser le mot pour ces fameuses « lésions indolentes ». Il est difficile voire impossible de définir rigoureusement le cancer, mais inévitable de le définir au moins par défaut. Décider d’intervenir c’est, qu’on le veuille ou non, qualifier implicitement de cancer la lésion sur laquelle on intervient : pour le décideur, tout cancer futur est un cancer présent.
Les déterminants non-scientifiques de la décision
Les éléments décisionnels sont plus universels et concernent aussi bien le traitement de l’hypertension et de la pré-hypertension artérielle, celui de l’hypercholestérolémie, du « pré-diabète », ou de la maladie d’Alzheimer. Il faut d’abord reconnaître, une fois pour toutes, que ces décisions sont prises sur la base d’un « cut-off » conventionnel. Conventionnel, cela veut dire que ce n’est ni objectif, ni arbitraire. Il existe des procédures pour qu’une convention soit bien établie : absence de pression, échange d’arguments, réduction de la zone de désaccord entre spécialistes, « accords sur les points de désaccord », etc. Mais aussi, prévalence importance de la parole des principaux concernés – les patients et surtout les futurs patients.
Même si une délibération en situation d’incertitude est une procédure rationnelle, le rôle des valeurs est, in fine, inévitable. Il existe des valeurs collectives qui s’imposent aux individus. Ainsi, éviter la perte de chances et réduire les inégalités d’accès aux soins sont des valeurs portées par le système de santé, pas nécessairement par ses usagers. Un citoyen ne saurait attaquer l’État pour des campagnes de dépistage parce qu’elles heurtent ses valeurs. Mais il existe aussi des valeurs individuelles : un médecin ne peut imposer le dépistage à un individu qui n’en veut pas, quelle que soit la manière dont il s’y prendrait, notamment, l’intimidation ou le reproche. Car le patient fait ses choix en matière de santé en fonction de ce qu’il valorise dans la vie. C’est aller bien vite en besogne que d’affirmer, comme on l’entend dire souvent aux professionnels de santé, que la santé est la valeur suprême. Demandez leur avis aux croyants, aux persécutés politiques, ou plus simplement aux professeurs : ils vous diront que la valeur suprême, c’est la conduite d’une vie irréprochable, que c’est la liberté, ou bien que c’est la connaissance.
Il n’est pas certain que le dépistage imparfait soit toujours un bienfait pour la santé. Mais il est certain que toutes ses imperfections sont une atteinte à une autre valeur « suprême » : le bonheur humain. Les imperfections du dépistage, c’est autant d’y recourir excessivement que de ne pas y recourir quand une vie pourrait être sauvée.
- par Maël Lemoine




