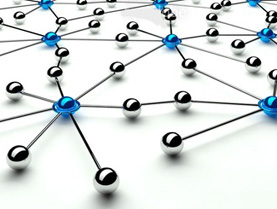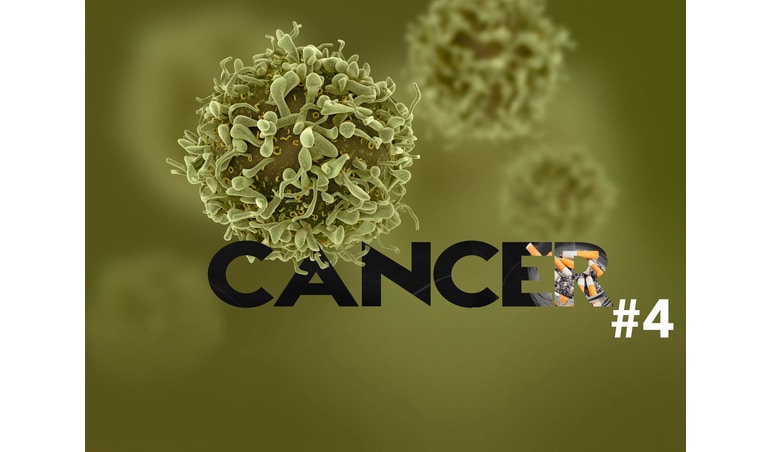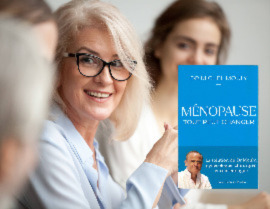Avancées et impasses sur le cancer / #4 Démasquer un cancérogène
La plupart des produits cancérogènes présumés ont un effet causal faible, difficile à établir faute d’une population exposée suffisamment grande. C’est la source de conflits sans fin entre industriels et militants, pouvoirs publics et citoyens. Médecins et scientifiques doivent trancher.
Par Maël Lemoine

Kurt Straif travaillait à l’International Agency for Research on Cancer, un établissement basé à Lyon. De 2014 à 2019, il dirigeait le département des monographies, ces études qui visent à identifier et classer les substances suspectées en cancérogènes, probablement cancérogènes, possiblement cancérogènes, probablement non cancérogènes et inclassables. Un poste hautement exposé. Il a joué un rôle dans les discussions autour du caractère cancérogène de la viande rouge et des charcuteries, mais aussi du glyphosate. Il a été attaqué personnellement pour des « prises de position » et un « agenda personnel » - par exemple par la Campaign for accuracy in public health research, financée par l’American Chemistry Council. Aujourd’hui, le département est dirigé par Mary Schubauer-Berigan, sous la supervision de Ian Cree.
Kurt Straif collaborait avec le groupe EBM+, un groupe de philosophes qui réfléchit aux méthodes de preuve dans le domaine de la santé, et qui plaide pour intégrer plus étroitement et plus rigoureusement les preuves de mécanisme aux preuves épidémiologiques et statistiques. Car c’est un problème fondamental de la recherche sur le cancer. L’industrie invente constamment de nouveaux composants aussi divers que des dérivés du pétrole et des nanoparticules, et ces nouveaux composants se répandent inévitablement dans l’environnement. Ces composants ne provoquent pas la mort immédiate de tous les individus qui les manipulent. S’ils tuent ou rendent malades, c’est nécessairement d’une manière difficile à détecter : effets tardifs, souvent peu spécifiques, et sur une partie de la population exposée.
Il est donc particulièrement difficile de les débusquer ; c’est une recherche qui prend du temps ; lorsque le caractère d’un cancérogène est établi ou, du moins, lorsque le grand public s’en méfie désormais, il peut parfois être immédiatement remplacé par une autre molécule, inconnue, qui est peut-être tout aussi cancérogène – voire l’est davantage. Mais cela prendra des années de l’établir. Certains scientifiques assurent que c’est ce qui s’est probablement passé avec le Bisphénol-A.
Critères scientifiques ou critères pragmatiques ?
Qu’il a fallu du temps pour qu’on reconnaisse enfin officiellement le rôle cancérogène du tabac ! L’histoire commence dans les années 1950 avec l’activité opiniâtre de quelques chercheurs, parmi lesquels, en particulier, deux britanniques, Doll et Hill. On avait observé depuis les années 1930 une augmentation alors encore inexpliquée, mais importante, du nombre de cancers bronchiques. Des hypothèses courraient. Par exemple, beaucoup pensaient que le goudronnage des routes pouvait être tenu pour responsable.
Pour établir l’hypothèse du rôle du tabac, Doll et Hill ont simplement comparé le nombre de fumeurs dans une population de patients atteints de toutes formes de cancer (622 sur 649), au nombre de fumeurs dans une population de patients atteints de cancer bronchique (647 sur 649). La probabilité que cette différence entre fumeurs et non-fumeurs dans les deux cas soit due au hasard, était d’une chance sur 1,6 millions.
Ce travail initial a été suivi de nombreuses autres études qui, toutes, convergeaient dans la direction d’une forte association entre consommation de tabac et cancer bronchique. La question pouvait être raisonnablement considérée comme scientifiquement résolue au terme d’une décennie de recherches environ. Mais il en fallu deux de plus avant que le lien de cause à effet soit reconnu par les tribunaux, et deux bonnes autres encore avant que l’industrie du tabac ne le reconnaisse à son tour.
Il y a deux manières de comprendre cette situation. On peut se dire que le fait est scientifiquement établi mais que sa reconnaissance par les acteurs prend du temps. On peut se dire aussi qu’un fait n’est jamais établi indépendamment des actions qui s’ensuivent : par exemple, il est suffisamment ou insuffisamment établi pour qu’on déconseille de fumer, pour qu’on interdise la cigarette, ou simplement pour qu’on pousse plus loin les investigations.
Il est commun d’adopter cette attitude pragmatique en santé publique. C’est source de malentendus, le grand public comprenant souvent une recommandation pragmatique comme un fait scientifique « établi » - et s’empressant d’interpréter les évolutions des recommandations comme des contradictions et des polémiques.
Il faudrait souvent observer des populations bien plus importantes que celles dont on dispose en réalité, pour être en mesure d’établir un risque absolu aussi faible que le risque de cancer auquel expose une substance potentiellement cancérogène
Comment mesurer un risque ?
Aussitôt qu’il est quantifié, le risque est un concept intrinsèquement relatif. On ne peut pas mesurer un risque autrement que dans une situation observée, et on ne peut que l’utiliser dans un contexte différent. C’est la fréquence d’un événement dans une situation donnée, interprétée comme une probabilité dans une autre situation. Cela peut être deux populations, ou la même population à deux périodes différentes. Elle est nécessairement comparable à certains égards, mais elle est nécessairement différente à d’autres égards.
Cette relativité ne doit pas être identifiée à la relativité du « risque relatif ». Au sens qu’on vient de définir, le risque absolu, à l’inverse est tout aussi « relatif » que le risque dit « relatif ». L’un et l’autre, en effet, sont mesurés dans une situation de base et extrapolés à une autre situation. En épidémiologie, le « risque relatif » est un rapport de risque – la fréquence d’un événement dans la population exposée divisée par la fréquence de l’événement dans la population non-exposée. Le risque absolu de cancer bronchique est ainsi très faible dans la population générale. Cela reste un événement rare chez les fumeurs. Le risque relatif de cancer bronchique chez les fumeurs est en revanche très élevé.
La relativité intrinsèque du concept de risque est une source inépuisable de remise en question et de doute. Mais dans le doute, que doit-on faire ? Quand il s’agit de cancérogènes, il est irréaliste de croire que le principe de précaution puisse prévaloir. Pour commencer, il faut détecter une substance et la nommer, avant de l’interdire.
La deuxième difficulté majeure pour l’épidémiologiste, c’est la puissance statistique. Il faudrait souvent observer des populations bien plus importantes que celles dont on dispose en réalité, pour être en mesure d’établir un risque absolu aussi faible que le risque de cancer auquel expose une substance potentiellement cancérogène. Même dans des situations aussi évidentes, apparemment, que dans le cas de l’exposition de la population de toute une région aux retombées radioactives d’essais nucléaires en plein air, la preuve que l’incidence des cancers de la thyroïde augmente est difficile à établir. Il faut souvent restreindre l’hypothèse de manière ingénieuse pour mettre un risque en évidence : identifier une population plus restreinte, mais beaucoup plus exposée et dans laquelle la taille de l’effet serait beaucoup plus importante.
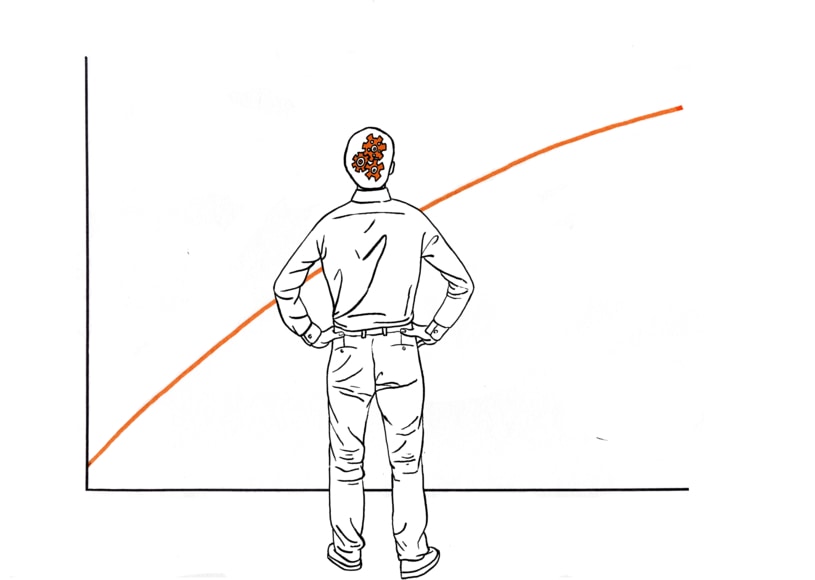
Pourquoi tant de substances sont-elles présumées cancérogènes ?
Il est frappant de voir combien de substances soupçonnées d’avoir un effet néfaste pour la santé, sont soupçonnées d’avoir un effet cancérogène plutôt que tout autre effet. Pourquoi déploie-t-on moins d’énergie à étudier l’effet possible de ces mêmes substances sur les maladies cardiovasculaires, qui tuent davantage que les cancers dans les pays développés ?
Une première explication possible serait le biais de détection. Obnubilés par le cancer, nous craignons de retrouver des cancérogènes partout. Il est vrai que l’histoire, elle aussi, nous incite à regarder dans cette direction. Le nombre de polémique autour de causes possibles du cancer est bien plus important que le nombre de polémiques autour des causes de toute autre maladie. Même si le tabac, l’alcool, la sédentarité et la charcuterie, pour s’en tenir à quelques exemples, sont tout autant des causes de maladies cardiovasculaires que des causes de cancer, le fait semble plus facilement admis dans le premier cas que dans le second (à l’exception de l’exemple de l’alcool). Cela tient probablement à l’image que nous faisons du processus de ces maladies : la métaphore du moteur et du tuyau encrassé rend plausibles les effets causaux de la fumée, de l’inactivité et de la graisse sur des « artères qui se bouchent », tandis que l’idée que le cancer est dû à des mutations rend plus abstrait le rôle causal de ces facteurs de risque pourtant aujourd’hui reconnus. Si les polémiques sont nombreuses, c’est donc bien qu’il existe un problème de preuve. Statistiquement, on peut établir un lien de corrélation entre un cancer et un facteur de risque donné ; mécanistiquement, il est plus difficile de se représenter la façon dont le second déclenche le premier. C’est une source de polémiques nombreuses, qui alimente à son tour un courant de suspicion dans l’opinion publique.
Une deuxième explication tient à la taille de la classe des maladies concernées. L’entité « maladie cardio-vasculaire » contient moins de subdivisions que l’entité « cancer ». Toute corrélation avec un cancer est une corrélation avec le cancer. L’augmentation du risque d’un cancer entraîne donc mécaniquement l’augmentation du risque de cancer, et rend aussi plus probable l’augmentation du risque d’un autre cancer.
On peut donc soupçonner d’être cancérogène (ou athérogène) toutes les substances dont la présence est négligeable dans l’environnement en quantité à un moment donné, mais constante tout au long de la vie, et qui produisent un effet d’accumulation.
Une troisième explication tient au fait que le cancer est une maladie liée à l’âge (tout comme les maladies cardio-vasculaires du reste). En tant que tel, le cancer ne présente ses effets que très tardivement. On peut donc soupçonner d’être cancérogène (ou athérogène) toutes les substances dont la présence est négligeable dans l’environnement en quantité à un moment donné, mais constante tout au long de la vie, et qui produisent un effet d’accumulation.
Une quatrième explication, plus spéculative, pourrait s’appeler l’hypothèse de l’entonnoir. L’étiopathologie de toute maladie peut être représentée par un entonnoir : à l’entrée du processus qui déclenche la maladie se trouve généralement plusieurs voies causales, qui se réduisent généralement à mesure qu’on approche du mécanisme typique de la maladie – sa physiopathologie. Certaines maladies sont des entonnoirs à bords étroits : cela signifie qu’il existe un petit nombre de voies étiologiques qui conduisent à l’installation de la physiopathologie. D’autres maladies sont des entonnoirs à bords larges : il existe dans ce cas un grand nombre de voies d’entrée dans la même maladie. Au regard de sa grande complexité biologique, mais aussi au regard de sa grande fréquence, le cancer peut être raisonnablement tenu pour l’exemple typique de la maladie « entonnoir à bords larges ». Ce fait pourrait justifier à lui seul qu’on soupçonne une substance donnée d’être cancérogène plutôt que tout autre chose.
Paranoïa ou laxisme ?
De manière générale, il semble sage d’exiger d’une hypothèse scientifique qu’elle soit soumise aux tests les plus sévères. Dans le cas des substances potentiellement cancérogènes, cependant, cela conduirait naturellement à n’accepter que les hypothèses les plus patentes, et à rejeter toutes les autres.
De même, si l’on ne devait accepter les hypothèses que lorsqu’elles sont étayées par la connaissance de mécanismes précis, mais pas lorsqu’elles sont appuyées seulement sur des corrélations statistiques, il y aurait un risque majeur de retarder des prises de décision pourtant protectrices de la population.
Un grand débat général sur l’attitude d’ensemble à adopter face aux suspicions serait stérile. D’un autre côté, dire que le pragmatisme et le « cas par cas » doivent prévaloir, c’est ne rien dire. Les institutions internationales ont des protocoles. Mais inévitablement, ceux-ci peuvent être, comme une constitution, interprétés dans plusieurs directions opposées. Il n’en demeure pas moins qu’un protocole est préférable à l’absence de protocole.
Les médecins sont en contact direct avec le public qui pose les questions et adopte les comportements. Ils sont en première ligne pour réduire les prises de risque insensées, mais aussi tempérer les crises d’angoisse injustifiées. Ils pourraient apprécier de disposer, eux aussi, d’un guide de prise en charge des patients exposés à un cancérogène possible, aussi bien après qu’un cancer s’est déclaré qu’avant qu’il ne se déclare.