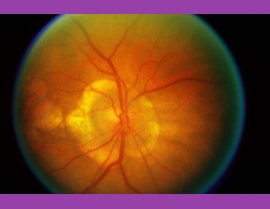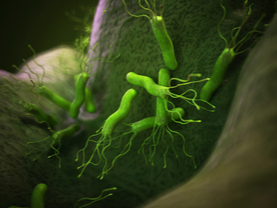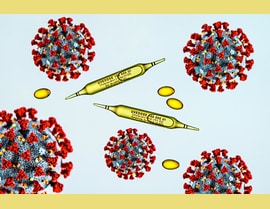Médicaments en psychiatrie : nocifs ou efficaces ?
Les petites pilules de la psychiatrie ont été accusées d’être des camisoles de force chimiques au moins autant qu’elles ont été louées de sauver du suicide des vies en perdition. Plus modérés, certains y voient une aide ponctuelle utile, d’autres y voient, au mieux, une sorte d’intermédiaire entre l’alcool et le placebo.
Par Maël Lemoine, philosophe des sciences médicales, université de Bordeaux.

On a souvent constaté quelle révolution l’apparition des neuroleptiques d’abord, puis des anxiolytiques et des antidépresseurs, a apporté à la prise en charge des troubles mentaux. On lui a attribué, sans doute à raison, la réduction de l’emprise des hospitalisations sur la vie des populations, mais aussi, les dérives d’une consommation aveugle et déréglée de médicaments par une vaste clientèle qui n’en aurait pas vraiment besoin. Ce serait un schéma simpliste d’expliquer la situation de la psychiatrie en France par les chiffres d’affaires de l’industrie pharmaceutique dans le secteur, et une position naïve que de les ignorer. On le dit moins souvent, mais c’est plutôt la situation de la psychiatrie en France qui éclaire une bonne part du chiffre d’affaires de l’industrie pharmaceutique. Nombre de médicaments très prescrits n’entrent pas dans la catégorie des psychotropes, et sont pourtant prescrits dans des syndromes vagues impliquant la « fatigue », comme le lévothyrox ou la vitamine D, mais aussi une grande quantité d’antalgiques. Le fait est révélateur d’une demande massive pour des médicaments peu spécifiques à connotation symptomatique « psy », qui ne soient pas associés à un diagnostic à proprement parler.
Champions du monde ?
C’est une antienne dans la grande presse : nous, Français, serions les plus grands consommateurs d’antidépresseurs de la planète. Ou de psychotropes. Ce serait un symptôme de notre profond mal-être, ou de notre inadaptation à la société moderne. Nous aspirerions à nous ressourcer dans une vie saine à la campagne, loin du stress du travail. Hélas ! nous n’y pouvons rien : nos téléphones portables nous rattrapent et, bien malgré nous, nous jetterions dans les bras consolateurs de l’industrie de la molécule psychotrope.
La réalité est plus complexe.
D’abord, il faut prendre acte de la faible spécificité des symptômes les plus fréquents en médecine générale. Vu le vague des diagnostics correspondants quoi qu’on en dise, on peut effectivement traiter un état identique, au choix, avec un antidépresseur, un anxiolytique, un neuroleptique, mais aussi du lévothyrox, de la vitamine D, de la valériane et même du Fentanyl. Cela dépend de la culture nationale, de la génération du médecin, de la présence de leaders d’opinion locaux, des représentations et de l’historique de consommation de la famille. Les Allemands sont faibles consommateurs de « benzos » mais consomment trois fois plus de Fentanyl que les Français, et les Anglais, cinq fois plus de buprénorphine.
Ensuite, il faut rappeler que, de loin, les plus grands consommateurs d’anxiolytiques sont les retraités et non les actifs, ce qui invalide la thèse de la vie professionnelle harrassante comme principale explication. Et avant de chercher une explication simpliste comme : les conditions de vie des retraités, on ferait bien de vérifier qu’il ne s’agit pas plutôt d’un effet d’habitudes de consommation prises par une partie de la population à une époque où les benzodiazépines étaient massivement prescrites.
Enfin, il faut s’interroger sur le fait que les femmes sont, de loin, les principales consommatrices – les champions du monde sont-elles des championnes ?
Les Allemands sont faibles consommateurs de « benzos » mais consomment trois fois plus de Fentanyl que les Français, et les Anglais, cinq fois plus de buprénorphine
À chaque problème sa solution ?
Massivement, les Français, consommateurs ou non, pensent que les psychotropes ne sont pas des solutions efficaces aux problèmes qu’ils sont censés traiter. Quant aux études scientifiques, elles dépendent naturellement de la manière dont on définit l’efficacité. S’il s’agissait de parler d’efficacité curative, naturellement, les psychotropes ne seraient pas efficaces. En définissant des objectifs trop modestes, comme réduire de quelques points le score de dépression sur l’échelle d’Hamilton, l’évaluateur risquerait de prendre des fluctuations pour des effets.
D’une part, il faudrait prendre en compte le poids des effets secondaires des psychotropes, à court et à long terme.
D’autre part, il s’agit de ne pas prendre pour une action du traitement l’évolution généralement favorable à court terme d’une crise dans la plupart des troubles mentaux.
On trouve sur ce site un exemple des difficultés et des subtilités de l’évaluation de l’efficacité des psychotropes, en l’occurrence les antidépresseurs [lire l'article "Une étude d'ampleur sur l'efficacité des antidépresseurs"].
Seulement voilà. Les effets des psychotropes qui convainquent les médecins de les prescrire ou les patients de les prendre, ont généralement peu à voir avec l’amélioration d’un état pathologique lui-même bien difficile à décrire rigoureusement. Contrairement à beaucoup de médicaments dont les effets ne sont constatés que sur des dosages biologiques, les psychotropes doivent avoir un effet subjectif pour convaincre. Et cet effet doit être clairement associé à la prise pour le patient. Faute de convaincre, le médicament risque de n’être pas pris.
Le bonbon consolateur
À l’inverse, le médicament psychotrope qui a un effet immédiat risque d’être pris seulement pour produire cet effet immédiat, ce qui incite à une consommation épisodique et irrégulière. Ce schéma de consommation n’est pas propice à la stabilité que recherche en principe le thérapeute, mais correspond pour le patient à un schéma de consommation dynamique « adapté » aux difficultés de sa vie. On prend en effet l’hypnotique ou l’anxiolytique en réponse à une insomnie ou à un état d’anxiété intense perçue dans des circonstances données.
Ceci est révélateur d’un amalgame dramatique pour la psychiatrie : l’idée qu’elle est aussi là pour aider les patients à traverser des moments difficiles de leur vie, comme si c’était un trouble mental que d’être en désarroi affectif, de réagir par des émotions intenses à des difficultés professionnelles, de s’inquiéter de la santé fléchissant de ses parents.
La population se trouve ainsi dans une position équivoque. Comme des clowns dans la fête foraine un peu trouble de la médicalisation, les psys font peur et leurs bonbons attirent les enfants que nous sommes. Alors nous demandons aux médecins généralistes, plus rassurants, de nous les prescrire à leur place.
Consommation de masse ?
Si l’on ne se focalise pas sur les seuls médicaments étiquetés « psychotropes » mais qu’on accepte une perspective plus large sur tous les médicaments vagues qui répondent vaguement à des situations de mal-être mal définies, nous avons une consommation de masse inquiétante. Certains parlent d’addiction au médicament. On peut préférer parler d’immaturité du consommateur que nous sommes tous, et du prescripteur que sont certains. Car l’addiction est encore une maladie pour laquelle il y aurait un remède, alors que pour sortir du schéma : « je me sens mal, je prends un médicament », c’est de la résignation et du réalisme qu’il faut. Si le médicament et le médecin pouvaient tout, les Français seraient à la fois les plus gros consommateurs et les plus heureux du monde. Mais nous admettons paradoxalement qu’ils sont les plus gros consommateurs parce qu’ils sont les plus malheureux du monde, et qu’ils sont les plus malheureux du monde bien qu’ils soient les plus gros consommateurs.
Cela révèle que beaucoup d’entre nous ne voient dans le médicament psychotrope pas plus qu’une honteuse bouteille dans le fond de laquelle on ne trouve pas la fin de ses problèmes.
Le psychotrope, et tous ses cousins qui encadrent la psychiatrie, devrait être d’un usage bien plus strict, dans un monde idéal, certes, mais aussi dans le monde réel. Et pour y parvenir, c’est d’éducation sur les psychotropes, de connaissances sur les troubles mentaux, et de distance sur la médicalisation du quotidien, que nous avons tous besoin.
[#Psy] Articles précédents
Psychiatriser ou dépsychiatriser ? [#Psy-2]