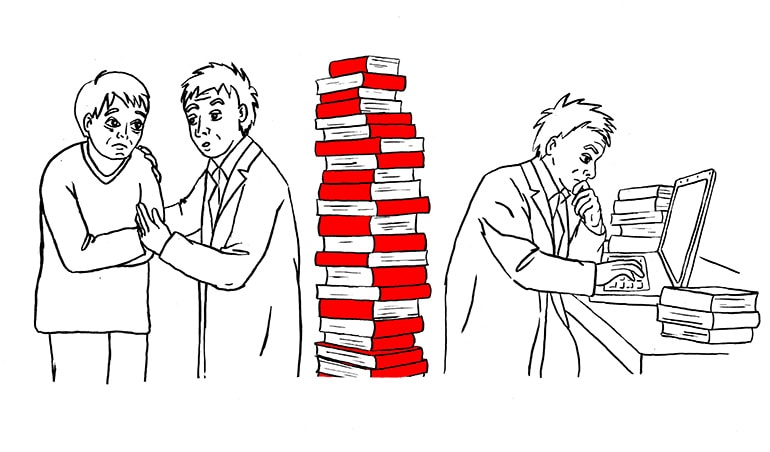
La psychiatrie partagée entre le soin et la recherche
Comme les personnages de la pièce, la psychiatrie attend un Godot qui ne vient jamais : la découverte majeure qui change à jamais la face du soin en psychiatrie. En attendant, elle négligerait sa propre maison.
par Maël Lemoine.

En psychiatrie, le soin souffrirait d’une fuite des fonds vers la recherche. Au coût d’une étude monopolisant l’IRM fonctionnelle, on finance un certain nombre d’heures de travail dans des structures périphériques où le personnel soignant manque. Le budget de la recherche publique en psychiatrie, même en partie financée par le privé, est cependant dérisoire en comparaison de la masse salariale du personnel soignant. Est-ce donc un faux problème ? Le vrai problème, pour beaucoup, est de se décider entre deux partis. D’un côté, constatant les faibles résultats du soin en psychiatrie, s’investir massivement dans la recherche. De l’autre, constatant les faibles résultats de la recherche en psychiatrie, s’investir massivement dans le soin tel qu’il existe aujourd’hui. Ce n’est pas une question de budget, mais de mentalités. Pour les décideurs, des ministres à la centaine de PU-PH qui représentent le sommet de la psychiatrie française, c’est un choix fondamental de plan pour espérer améliorer l’état de santé de la population.
Le désert des Tartares de la recherche
Qu’est-ce qu’une percée majeure en psychiatrie ? Pour le grand public, il s’agirait d’une intervention thérapeutique qui guérisse définitivement et sans effets secondaires notables l’un des grands troubles mentaux : dépression, anxiété, schizophrénie, trouble bipolaire, troubles du spectre autistique. Chaque pas dans cette direction est une percée, certes, mais un peu moins majeure. En se racontant beaucoup d’histoires, on peut finir par se convaincre que la découverte d’une mutation génétique présente chez 15 % des patients schizophrènes, et qui fait passer le risque de développer ce trouble de 0,01 à 0,013, est une percée majeure. Mais il va falloir beaucoup de force de conviction pour en convaincre le grand public, bien moins crédule sur ce point, apparemment, que les relecteurs de la prestigieuse revue Nature.
Pour un chercheur, cependant, le shoot d’endorphine est puissant lorsqu’il accède à ce Graal de la publication spécialisée – même si un Molecular Psychiatry n’est pas déshonorant. Si puissant qu’un doctorant dont les premières recherches seraient publiées dans cette revue, mais aucune autre dans les 10 années qui suivent, serait pourtant assuré de se trouver une belle position professionnelle.
Pourtant, demandez au personnel infirmier qui travaille avec cette graine d’hospitalo-universitaire que les équipes françaises vont s’écharper pour attirer chez elles. Ce garçon est très gentil. Quand on le voit dans le service. Pas de secret, cependant : même s’il proteste le contraire, les patients, il n’aime pas ça, du moins pas autant que le laboratoire et les revues de littérature. Et il vaut mieux pour lui, car hormis le coup de chance, cela va lui demander beaucoup, beaucoup de travail et de disponibilité d’esprit de réaliser cette percée majeure. A défaut de changer le cours de la carrière des patients, cette publication dans Nature changera le cours de sa carrière. La première issue n’est pas impossible, quoique très improbable, mais la seconde est quasiment certaine.

Les chercheurs en psychiatrie sont comme les soldats du Désert des Tartares : l’œil rivé sur un désert d’où il ne vient jamais rien, ou presque. Car si l’espoir vient de la recherche, il faut s’enfermer dans une citadelle pour le préserver des assauts du quotidien et du lot de banale souffrance que portent des patients dont la clinique n’a, semble-t-il, plus rien à nous apprendre sur leurs troubles, ou presque. Tant qu’on n’a pas encore les résultats de telle étude que l’on mène, on se raconte l’histoire d’une potentielle révolution scientifique. Aussitôt qu’ils sont tombés, on se raconte l’histoire du progrès incrémentiel. Ce SNP pourrait être un game-changer. Prononcez : « snip », il s’agit d’une mutation d’un simple nucléotide découvert dans un séquençage du génome d’une population de patients. Et utilisez cette expression galvaudée des revues scientifiques : le game-changer est une révolution scientifique. Mais quand il s’avère que rien de si important n’a été découvert, sortez l’attirail des termes à fonction apologétique, comme « complexité », « au milieu du gué », « on progresse ». Puis revenez à la rhétorique du succès. Car tout demi-échec est un succès en puissance.
Le tonneau des Danaïdes du soin
On rencontre facilement des praticiens hospitaliers révoltés par l’indisponibilité de leurs supérieurs accaparés par la recherche ou biaisés dans leurs approches de l’enseignement : car les PU-PH, qui en sont également responsables, l’orientent massivement, quoique non exclusivement. Mais que font-ils eux-mêmes ?
Ils s’occupent au quotidien de patients dont l’état « s’améliore » ou « s’aggrave ». Qu’est-ce qu’améliorer l’état d’un patient qui souffre de trouble bipolaire ? C’est, par exemple, trouver la dose et le médicament qui le stabilisent durablement sans trop d’effets secondaires, du moins, s’il prend correctement son traitement. Pour le grand public, décidément toujours bien nigaud, le succès serait plutôt avoir obtenu une rémission parfaite, la résilience et non l’équilibre précaire sans cesse menacé par une émotion un peu vive. Ce serait le sourire qui ne vire pas à la manie, la profonde tristesse qui passe au lieu de se transformer en un épisode de prostration permanente. Mais les praticiens du soin aux personnes souffrant de troubles mentaux sont réalistes et ne se racontent pas d’histoire. Comme les enseignants se réjouissent du « grand progrès » d’un enfant dans lequel ils ont investi leur énergie et leur espoir, les soignants sont à l’affût de la moindre amélioration incrémentielle. C’est, d’ailleurs, toujours ça de gagné sur la maladie.
A la vérité, il est facile de conclure que le soin en psychiatrie tourne en rond. Il est vrai qu’il demande une humanité et une attention aux autres exemplaires et parfois héroïques. Mais ce qui nous intéresse n’est pas la vertu des soignants, c’est l’amélioration de l’état des patients. Incontestablement, l’existence de structures de soin permet de prévenir des aggravations, de contenir des crises, de désamorcer des situations explosives et, parfois, de résoudre des problèmes pour de bon. Incontestablement, si le personnel y était un peu moins débordé, il pourrait mieux faire. Mais il ressemble aux religieux qui s’occupaient autrefois de la misère humaine, ou, si l’on préfère, au chirurgien d’un hôpital de guerre. Parer au plus pressé, ne jamais rien achever ou presque, encaisser des coups, et toujours voir arriver une vague de patients plus grande que la précédente, comme si dans l’océan des souffrances, la marée ne refluait jamais. Quand l’état des patients s’améliore, on ne sait jamais si c’est spontanément ou grâce aux soins. Pour certains soignants, c’est déjà bien d’avoir veillé, pendant les crises, à ce qu’elles ne s’aggravent pas irrémédiablement.
A la vérité, il est facile de conclure que le soin en psychiatrie tourne en rond. Il est vrai qu’il demande une humanité et une attention aux autres exemplaires et parfois héroïques. Mais ce qui nous intéresse n’est pas la vertu des soignants, c’est l’amélioration de l’état des patients.
Tout comme les Danaïdes de la mythologie grecque furent condamnées à remplir sans fin un tonneau percé, les soignants sont vite gagnés par le sentiment que leur travail est à la fois nécessaire, et vain. Les plus grands changements de la pratique de la psychiatrie au XXe siècle sont venus des médicaments psychotropes. La découverte d’un nouvel outil thérapeutique peut seule changer quelque chose à la misère qu’affrontent tous les jours les soutiers du soin.
Faire (mal) un peu des deux ?
Tel est le choix auquel les décideurs doivent faire face : consolider les remparts et les combattants des troubles mentaux et abandonner l’espoir que les renforts de la recherche viendront ; ou bien capituler sans le dire dans la bataille actuelle, en envoyant ses généraux chercher des armes nouvelles aux quatre coins du monde. Aucune équipe universitaire de psychiatrie n’est investie exclusivement dans la recherche ou exclusivement dans le soin : la structuration de la carrière hospitalo-universitaire le veut ainsi. Mais ça se saurait, si le fait que la loi vous confère deux missions valait preuve qu’elles sont compatibles et qu’on peut bien les remplir toutes les deux.
Il y a des choix stratégiques à faire et quelques écueils majeurs à éviter. L’erreur majeure est de continuer, une fois le poste universitaire obtenu, à prendre la publication dans Nature pour le but en soi d’une carrière de chercheur en psychiatrie. Dans des pans entiers de la recherche médicale, on peut se permettre de jouer sur des découvertes marginales publiables dans de grandes revues, parce que la situation est, somme toute, assez satisfaisante. Pas en psychiatrie. La faute majeure serait de négliger les patients d’aujourd’hui pour se préoccuper d’améliorer peut-être, mais sans doute pas, la santé de ceux de demain. Cela étant, il faut absolument alléger la surcharge des services de soins psychiatrique en acceptant de démédicaliser une partie des situations de détresse qui en relèvent aujourd’hui. Il faut absolument que parents et enseignants se sentent plus compétents et mieux armés face aux nombreux troubles qui menacent le développement et l’épanouissement des enfants dont ils ont la charge. Il faut que les citoyens se sentent plus investis de la responsabilité qu’ils ont de faire face à la souffrance et aux ornières de leurs proches et de leurs prochains, de leurs voisins et des passants. Non pas parce qu’ils le doivent moralement. Mais parce que c’est dans notre intérêt à tous de laisser aux soignants et aux chercheurs, en psychiatrie, un peu d’espace pour s’occuper mieux des patients d’aujourd’hui et réfléchir aux moyens de prendre en charge ceux de demain.
- par Maël Lemoine




